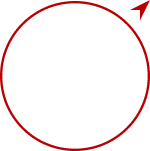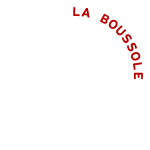Syndicalismes en Suisse : état des lieux et perspectives
Rassembler des travailleur·euses entre elleux et les organiser n’est pas tâche facile dans une société néolibérale où les élites politiques et économiques bourgeoises essaient sans relâche de diviser la classe populaire, notamment entre les travailleuse·eurs nationales·aux et immigré·es.
Cela est encore plus marqué du fait que le syndicalisme vit une véritable crise en Europe, à laquelle il est possible de donner de nombreuses causes : transformation structurelle de l’emploi avec déclin des grandes industries, campagnes de dénigrement des syndicats dans les médias, recours aux tribunaux. Le rapport de force changeant entre travailleuses·eurs et le côté patronal n’est clairement pas sans conséquences. Le pouvoir d’achat baisse et les patron·nes enfreignent les droits des travailleuses·eurs sans pression. Ainsi, la Suisse est passé en 2023, selon la Confédération syndicale internationale, à un stade de « violations régulières des droits [du travail et de la liberté syndicale] ».
Le paysage syndical suisse
Il est donc désormais nécessaire d’étudier les perspectives qui s’offrent au syndicalisme en Suisse et, pour cela, il est crucial de comprendre la situation actuelle. Il existe deux grandes faîtières syndicales en Suisse : l’Union Syndicale Suisse et Travail.Suisse. La première comprend plus de 315’000 membres et est composée, entre autres, d’Unia, du Syndicat du personnel des transports (SEV), du Syndicat des services publics (SSP) et de Syndicom. La seconde, environ deux fois moins forte numériquement que l’USS, comprend diverses fédérations syndicales chrétiennes.
Il est donc par là possible de voir que le syndicalisme n’est pas un mouvement unique de rassemblement de travailleur·euses pour défendre leurs droits. Au contraire, il existe une pluralité de syndicalismes, dont d’autres formes minoritaires telles que l’anarchosyndicalisme (la FAU en Suisse, ou la CNT en Espagne). L’USS étant la faîtière la plus profondément marquée par les valeurs sociales qui caractérisent fondamentalement notre parti, nous en sommes plus proches idéologiquement.
À l’inverse, les syndicats de Travail.Suisse ont une plus grande proximité avec la pensée chrétienne-sociale. Aujourd’hui, le christianisme ne s’incarne que résiduellement dans les valeurs des syndicats chrétiens, mais il y a eu historiquement une claire division des travailleuses·eurs entre celleux qui s’identifiaient au christianisme et celleux qui s’identifiaient à une classe sociale.
En effet, les premiers groupes chrétiens d’ouvrière·ers qui s’étaient réunis en syndicat dans les années 1890 en Suisse l’ont fait comme une manière alternative au socialisme de lutter contre les problèmes sociaux de l’industrialisation. Le socialisme était craint par les autorités religieuses car, en tant que mouvement matérialiste, il avait une position athée. Le syndicalisme chrétien était donc une manière de lutter contre le socialisme tout en reconnaissant les ravages sociaux du système économique de l’époque.
Comment sont financés les syndicats ?
Pour comprendre le système actuel, il faut aussi comprendre d’où viennent actuellement les ressources des syndicats en Suisse.
Il n’est pas possible de généraliser la question du financement, car l’importance de chaque source de revenu varie selon le syndicat et la région ou le secteur dans lequel il est implanté. Deux des grandes ressources financières des syndicats sont les cotisations de leurs membres et les contributions professionnelles.
Ce que l’on appelle “contributions professionnelles” désigne une contribution de l’employeur·euse mais aussi un certain pourcentage retiré directement sur le salaire des travailleuse·eurs protégé·es par une convention collective de travail (CCT) qui est versé, en partie, aux syndicats. Les CCT sont des accords négociés entre les patron·nes et les représentant·es des travailleuse·eurs. Elles proposent une amélioration et une harmonisation des conditions de travail dans un secteur ou pour une profession en échange de l’adhésion des travailleuse·eurs aux principes de la « paix du travail », c’est-à-dire que les conflits collectifs ne doivent plus être réglés par la lutte, plus spécifiquement la grève, mais au contraire par la négociation et le dialogue social. Les représentant·es du côté employeuse·eur et employé·e doivent ainsi créer un cadre institué pour négocier et devenir des “partenaires sociaux”.
Le partenariat social
Le concept de partenariat social est plus ou moins critiqué ou accepté d’un syndicat à l’autre. Les syndicats chrétiens tels que Syna, par exemple, ont comme valeur fondamentale la loyauté au partenariat social. Cependant, nous autres socialistes ne pouvons défendre aveuglément le partenariat social, et ce pour plusieurs raisons. En effet, l’abandon de l’arme la plus forte des travailleuses·eurs qu’est la grève est mortifère, car c’est grâce à celle-ci qu’il est possible de faire pression sur les employeuse·eurs. Accepter le partenariat social, c’est donc se démunir face à la bourgeoisie, tout en affaiblissant les syndicats puisque les grèves ont un pouvoir de politisation des masses et sont une source importante de recrutement syndical.
Cependant, les CCT apportent de nombreux avantages sociaux et salariaux non négligeables et les abandonner serait néfaste, sur le court terme en tout cas, pour la classe populaire. De plus, certains syndicats dépendent très fortement des contributions professionnelles pour fonctionner, car celles-ci peuvent représenter une grande partie de leur financement. Ainsi, les employeuse·eurs peuvent menacer de dénoncer la CCT si des détériorations des conditions de travail sont refusées par un syndicat, ce qui mettrait autant les employé·es soumis·es à la CCT que le syndicat dans une situation précaire.
Un point est cependant très important dans une perspective marxiste : les classes populaires et la bourgeoisie ne peuvent fondamentalement pas être des “partenaires”, car les intérêts de ces deux classes sont en opposition. La question du partenariat social est donc très complexe à résoudre avec les nombreuses implications qui en découlent, mais tant qu’elle n’est pas résolue, les syndicats ne peuvent être que réformistes. Cela entraîne donc une certaine sclérose, puisque la situation n’a pas de solution qui n’entraînerait pas de nombreux sacrifices.
Vers un syndicalisme élargi
Mais quelles sont donc les perspectives imaginables pour les syndicats si leur position intégrée au système en tant que partenaire social n’est pas susceptible d’évoluer ? Face à cela et aux différentes causes de la crise syndicale évoquées précédemment, il est important d’élargir leur domaine d’action.
Certains syndicats ont déjà une vision de la défense de la classe populaire qui ne s’arrête pas aux conditions de travail mais qui englobe aussi les autres domaines du monde politique et social. Il faut lutter pour renforcer et étendre encore cette vision ! Un syndicalisme non conscient des problèmes sociaux et économiques actuels en Suisse, ainsi que ceux du capitalisme en général, ne peut nous amener que droit au mur !
Il faut tenir compte de la position structurellement inférieure des femmes et des personnes racisées dans la société, et non pas seulement de la question de classe. De plus, le syndicalisme doit aussi proposer une vision écologique du monde du travail, car ce sont les personnes précaires qui souffriront le plus de la crise climatique.
Ainsi, un éco-syndicalisme féministe et antiraciste doit être l’horizon vers lequel nous nous dirigeons si nous voulons que la lutte des travailleuse·eurs ne soit pas inutilement fragmentée. Il est donc le devoir de tou·te travailleuse·eur socialiste de s’engager dans les syndicats par solidarité, pour renforcer notre position dans le rapport de force contre les patron·nes et pour porter ces luttes !
Crédits
Image : Manifestation nationale pour l’égalité salariale par Gustave Deghilage sous licence CC BY-NC-ND 2.0.
Cet article a été écrit par Julien Berthod et est placé sous licence CC BY-SA 4.0. Vous pouvez le réutiliser et le citer gratuitement, à condition d’en attribuer l’auteur·e et de publier toute création dérivée sous la même licence ou une licence compatible.
Pour attribuer cet article :
“Syndicalismes en Suisse : état des lieux et perspectives” par Julien Berthod, CC BY-SA 4.0. Source : https://laboussole.cc/posts/syndicalismes-en-suisse-etat-des-lieux-et-perspectives/